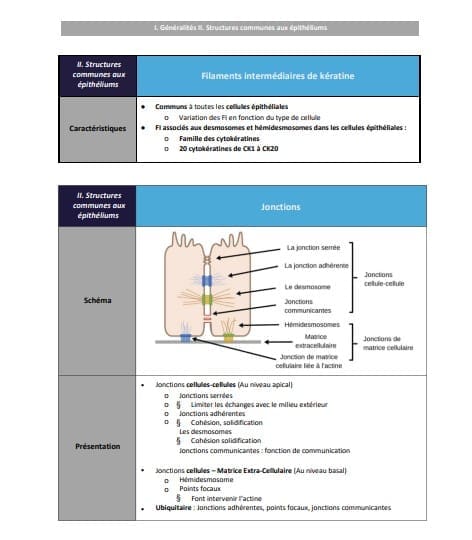Réussir vos études de santé
A la une
25/02/2026
Tu es en terminale, en réorientation ou tu prépares ton dossier Parcoursup, et tu te retrouves face à une dizaine de prépas médecine à Paris qui se ressemblent toutes sur le papier. Mêmes promesses, mêmes arguments, mêmes mots-clés. Alors comment t'y retrouver...
Kiné, Médecine, Orientation Filtrer :
25/02/26
Réussir sa lettre de motivation Parcoursup est essentiel pour intégrer une PASS, LAS ou LSPS. Avec la réforme de l'accès aux études de santé, les facultés parisiennes ne se contentent plus de survoler vos notes de spécialités. Elles scrutent votre Projet de For...
Kiné, Médecine, Orientation
12/12/25
Chaque année, de nombreux candidats découvrent avec incompréhension qu’un bon dossier Parcoursup ne suffit pas toujours pour être admis en PASS. Excellentes moyennes, spécialités scientifiques, appréciations élogieuses… et pourtant, une place en liste d’at...
Kiné, Maïeutique, Médecine, Odontologie, Orientation, Pharmacie
30/11/25
À la croisée de l’excellence académique et de la stratégie individuelle, cette prépa a su imposer une vision différente et efficace de la préparation aux études de santé.
Kiné, Maïeutique, Médecine, Odontologie, Orientation, Pharmacie
27/02/26
Intégrer la deuxième année de médecine, de pharmacie, de maïeutique, d'odontologie ou de kinésithérapie : c'est l'ambition de chaque étudiant qui s'engage dans la voie du PASS. Mais entre l'enthousiasme de la rentrée et les résultats du premier concours, la r�...
Kiné, Médecine, Orientation
27/02/26
Depuis la réforme du numerus clausus en 2020, trois voies permettent d'accéder aux études de santé en France : le PASS (Parcours d'Accès Spécifique Santé), la LAS (Licence Accès Santé) et, dans certaines universités franciliennes, la LSPS (Licence Sciences pou...
Kiné, Médecine, Orientation
25/02/26
En ligne ou en présentiel ? C'est l'une des premières questions que se posent les étudiants qui cherchent une prépa médecine à Paris — et souvent l'une des plus difficiles à trancher. Depuis que les formats hybrides se sont généralisés, l'offre s'est diversi...
Kiné, Médecine, Orientation
25/02/26
Tu es en terminale, en réorientation ou tu prépares ton dossier Parcoursup, et tu te retrouves face à une dizaine de prépas médecine à Paris qui se ressemblent toutes sur le papier. Mêmes promesses, mêmes arguments, mêmes mots-clés. Alors comment t'y retrouver...
Kiné, Médecine, Orientation
25/02/26
Réussir sa lettre de motivation Parcoursup est essentiel pour intégrer une PASS, LAS ou LSPS. Avec la réforme de l'accès aux études de santé, les facultés parisiennes ne se contentent plus de survoler vos notes de spécialités. Elles scrutent votre Projet de For...
Kiné, Médecine, Orientation
6/02/26
Les études dentaires en Espagne attirent chaque année de nombreux étudiants européens, notamment français, en raison d’un système universitaire structuré, d’une formation professionnalisante reconnue en Europe et, souvent, d’une entrée sans concours comme ...
Kiné, Médecine, Orientation